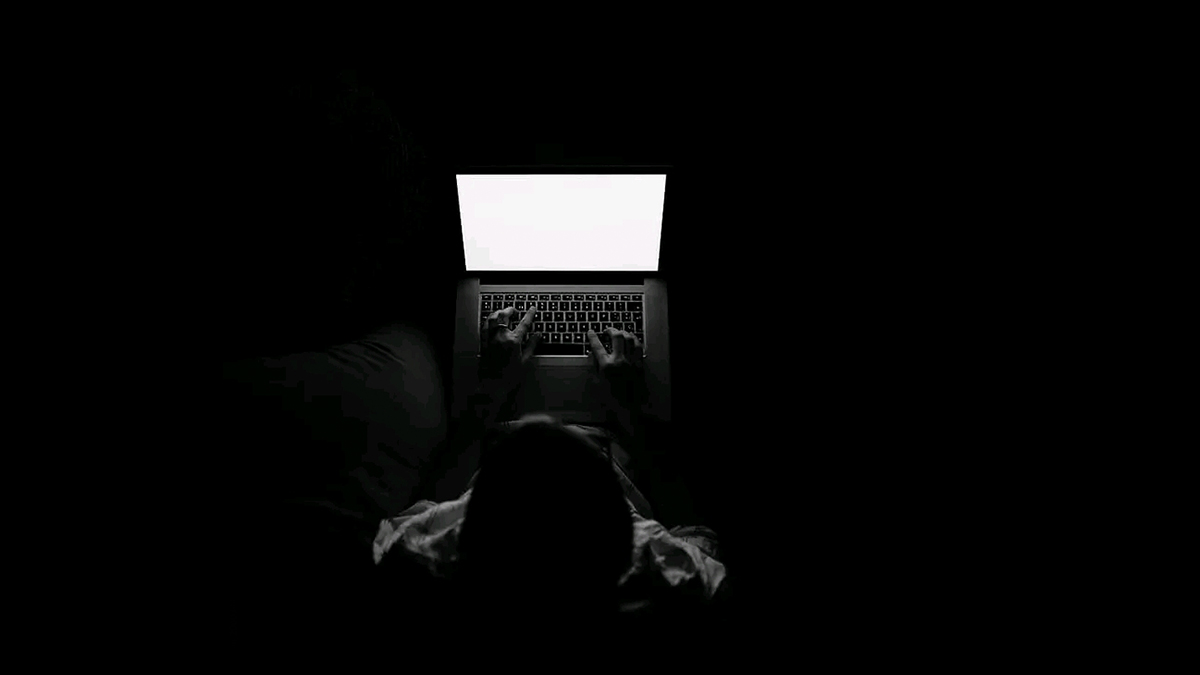
Il est huit heures et demie. Tu sais, à chaque fois que je reçois ta lettre, je m’attends toujours à ce que les mots ne soient pas aussi tranchants que la lame du couteau avec lequel on a tué un de nos potes à Port-au-Prince. Dommage. Le temps passe et c’est toujours depuis un autre lieu du temps que nous essayons de comprendre une chose advenue chez l’humain. Le temps passe, et le monstre, en l’homme, reste et demeure. Le temps n’existe pas pour l’homme qui hait le verbe aimer. On a fait la guerre. On fait la guerre. On fera la guerre. On détruira les autres parce que…quoi. Rien. Je vois tout à la télé. Parfois, je voulais casser le mur avec lequel je partage mes nuits blanches où la mort veut toujours me rendre visite, la télé qui donne les nouvelles des terreurs des gangs de mon pays. MOI, AUSSI. Tout. Oui Bell, la mer nous fait mal. J’ai peur d’elle. Je crois toujours que ce tombeau est à brûler, mais c’est avant qu’elle me rend mes nègres de la Méditerranée. Mes frères du Canal de Mona. Mes potes de la Pacifique. TOUT, les rêves de mes ancêtres, Aussi.
Seul au monde, je suis. Tu ne t’es jamais senti aussi seul qu’à cet instant. Tu es devenu plus inaccessible que jamais. Plus personne ne peut t’atteindre et tu t’en délecterais. Tu n’analyses pas tes états d’âme, mais les sensations s’imposent à toi comme de claires pensées, et ta plus vive source de jouissance est sans doute cette impression de n’avoir plus rien à comprendre. Tu parviens à fermer la main, et quand tu la rouvres, une fleur de lotus violette aux pétales frangés de rouge s’épanouit, dans la lumière resplendissante de la nuit qui s’achève. Seul avec ses émotions froides, ses envies d’habiter sa terre. De revenir à la maison. De dire bonjour à sa grand-mère. Voilà, tu es loin de tes racines. Loin de ceux qui te font sentir avoir les pieds sur terre. Mais près de ceux qui vous crient sale nègre même quand tu essaies de rire, de regarder la nuit qui dort et le soleil qui se met debout.
Tu m’as dit que les hommes peuvent m’empêcher de regarder les merveilles du monde. T’as raison. Quelquefois, je me hais et je veux être l’autre. Quand je dis le mot : l’autre, ce n’est qu’un mot pour moi. Sourde douleur qui ne me quitte pas. Odieux silence. Le ciel doit savoir que je veux être l’autre. L’autre qui rit. L’autre qui ne côtoie pas la mort chaque jour. L’autre qui vit sans le poids des larmes des autres. L’autre qui ne marche pas à pas pressés dans sa ville. L’autre que sa terre veut de lui.
C’est à peu près comme si les freins de ton vieux vélo lâchaient au sommet de Morne Tapion. Irrésistible-ment, tu prends de la vitesse. Le temps qui file à toute allure te blanchit les tempes. Tu ne roules plus, tu glisses. Tu restes dans cette chambre, sans voir comment dehors se déhanche. Sans voir la beauté des jours. Sans voir comment tomber la pluie qui ne mouille pas les nègres comme toi. Ta vie est de course, de sable et d’eau courante. Si tu ne cours pas, on te bastonne.
L’homme-monstre comme ceux qui te crient “haitiano el diablo” ne connaît pas le temps qu’il fait quand il est temps d’aimer. Il est huit heures quarante cinq, tout espoir est enseveli sous les fatras. La république continue d’écrire sa petite histoire de sang. Son journal d’horreurs…